Comment ne pas se "laisser mener en
barque"
"Manipulation", "lavage de cerveau", "déstabilisation
mentale"... Illuminisme sous toutes ses formes, danger des extrémismes, sectes à
peine voilées, O.T.S., Heaven's Gate et autres, qui rendent la navigation périlleuse.
Pourtant nous ne voulons pas nous laisser mener en bateau, exigeant d'être bien informés
pour décider nous-mêmes de la route à suivre, en toute connaissance de cause, pour nous
fier à la boussole de notre volonté et de notre libre-arbitre.
Il y a certains chemins spirituels, certaines démarches initiatiques qui peuvent
séduire, mais elles sont néfastes et risquent de finir par le naufrage, car elles sont
fondées sur le mensonge, la violation de nos droits les plus élémentaires (dont celui
de savoir). D'autres me semblent condamnables car ils reposent sur des contraintes
physiques ou psychiques, sur des menaces (explicites ou implicites), sur l'abus de l'état
de faiblesses des mineurs, des gens en précarité de vie ou des malades.
Je crois qu'il existe un certain nombre de signes, de "balises" qui permettent
dé déjouer les pièges de ces récifs tortueux.
Baliser les zones de manipulation
Il ne s'agit d'une recette infaillible, mais plutôt d'un repérage à partir de
symptômes avertissant l'arrivée dans des zones à risques, car favorables à la
manipulation sous ses diverses formes:
1. le contrôle du milieu:
depuis l'enfermement physique (la prison), jusqu'au camp de rééducation, en passant par
la rétention de l'information (ou son contrôle, quand ce n'est pas sa manipulation). Il
s'agit là d'une forme de totalitarisme par la confusion des différents pouvoirs (le
législatif, l'exécutif, le judiciaire, l'information), et par l'absence de limites à
l'intérieur de chacun de ces pouvoirs.
L'individu perd sa capacité de réfléchir, de prendre le recul nécessaire pour faire la
distinction entre le moi et l'extérieur. La pression communautaire et l'exaltation
commune font que chacun doit s'identifier au sentiment d'omnipotence médiatisé par
l'appartenance inconditionnelle au groupe. Y échapper relève de l'exploit.
2. la manipulation "mystique":
dirigée "d'en haut", elle a pour finalité de provoquer un ensemble de
comportements et d'émotions déterminés, conditionnés, mais de façon qu'ils soient
perçus comme spontanés. La vérité a été révélée par Dieu à quelques rares
privilégiés, auxquels il s'agit d'obéir pour accomplir le but supérieur.
3. l'exigence de pureté ou de sainteté:
le monde est divisé rigoureusement entre le pur et l'impur, entre le bien absolu et le
mal absolu (dualisme). Personne n'est à l'abri, car toutes les souillures, tous les
poisons doivent être recherchés et éliminés? Honte ou culpabilité à ceux qui ne
répondent pas totalement à l'exigence de perfection absolu (un état à garder plutôt
qu'un processus à suivre)
4. le culte de la confession: dire
sur le registre de l'aveu tous les crimes tous les méfaits. Voilà encore un bon moyen
d'exploiter les vulnérabilités ou les fragilités (sentiment de culpabilité morbide,
honte car on n'est pas à la hauteur des exigences des autres, sentiment d'une dette
contractée suite à la désobéissance face à une loi omnipotente ou face à un juge
implacable).
Mal comprise, la confession devient ainsi une sorte de reddition symbolique, une
abdication de la capacité de jugement, et surtout le moyen de maintenir une transparence
totale vis-à-vis des autres, de l'organisation (du guru), qui doit connaître tout le
passé, les pensées (aspect cognitif), les passions (aspect affectif), les expériences
(aspect existentiel et relationnel). Comble de la dépendance et du mimétisme, du
conformisme social, ou l'uniformité remplace l'unité.
5. la science sacrée: les doctrines
de base sont présentées comme les seules véridiques et dignes d'être suivies. Elles
représentent la vérité ultime, sans aucune remise en cause possible. La révélation
est acceptée de manière inconditionnelle.
6. le langage codé: n'est accessible
qu'aux rares initiés, et il chargé d'un contenu affectif et mystique important. Les gens
de l'extérieur, du "monde" ne peuvent le comprendre.
7. la doctrine l'emporte sur la personne:
l'expérience humaine est subordonnée aux exigences de la doctrine, l'expérience
personnelle est moulée dans un carcan d'interprétation conforme au catalogue officiel,
ce qui empêche toute innovation.
8. le pouvoir absolu sur l'existence:
la personne individuelle est inféodée à l'orthodoxie, son mode de pensée et d'agir est
calqué sur la doctrine définie de manière absolue et définitive. Le droit souverain
d'accorder ou de refuser l'existence revient à prendre la place de Dieu ou d'un dieu, ce
que le chef charismatique accepte d'autant plus volontiers qu'il devient objet d'adoration
à la place des principes spirituels prônés
9. le rétrécissement intellectuel
et l'appauvrissement affectif en sont les conséquences inévitables, privant l'homme de
son imagination et de sa créativité.
10. l'adaptation sociale est
sérieusement remise en cause par la totale dévotion au groupe ou à son idéologie.
Je pense qu'il est important de clarifier le problème en matière de foi religieuse, car
croire n'est pas forcément synonyme de manipulation.
Je crois en Dieu : croire et croître en Lui
Le chrétien auquel vous demandez de définir sa foi vous dira certainement : " je
crois en Dieu ". Du point de vue psychologique, on peut définir la foi comme une
organisation dynamique d’éléments conscients ou inconscients, affectifs
(sentiments), physiques, cognitifs (pensées), relationnels (liens établis avec des
personnes, des liens, des expériences), sociaux, économiques et culturels. Elle
s’exprime en termes de croyances, de sentiments, de comportements, d’actions et
d’engagements.
1. La foi mûre et ses principales caractéristiques
Intimement imbriquée dans le cheminement de la vie, la foi n’est pas un état dans
lequel je m’installe, mais un processus dynamique auquel je participe, avec des
étapes de maturations ou des degrés de progrès possibles (sans exclure des
régressions). Nous aimons à parler de la foi mûre (ou mûrie) avec ses principales
caractéristiques :
* elle est marquée par le fait qu’elle n’est pas
contaminée par des désirs enfantins, naïfs, teintés de caprice, par la prédominance
du désir, de l’instabilité et de la versatilité ;
* elle s’exprime par un engagement uni et cohérent, en faveur du prochain et de
Dieu, fondée sur des convictions solides, mais reposant aussi sur des interrogations qui
subsistent encore : " Heureux les pauvres en esprit ", ceux qui vont vers le
monde en l’interrogeant, pour y découvrir les merveilles jusque là ignorées ;
* elle permet d’envisager la relation avec l’Etre supérieur qui s’est
révélé à nous en Jésus-Christ par le processus de l’incarnation, et que nous
pouvons appeler Père, créateur, Seigneur…., être qui nous dépasse, mais qui est
proche de nous, être qui donne la vie, et surtout un sens à notre vie ;
* elle correspond à une expérience personnelle et collective profonde, ouverte à
l’éventualité du miracle, cherchant la joie, le bonheur (plus durable), la
liberté, le dépassement du découragement passager ;
* elle débouche sur des actions au sein d’une bonne intégration ecclésiale
(église) et sociale, au cœur d’une ouverture au monde, aux autres, avec la
capacité d’initiative créatrice au niveau intra- et interpersonnel ;
* elle permet de résister aux pressions sociales même en cas de crise (autonomie et
utilisation du libre arbitre dans le choix de ce qui est juste et bon),
* elle dessine un cercle d’amis proches et intimes, nécessaires au partage et à
l’échange, dans le cadre de la communion dans la communauté (ekklésia et
koïnonia)
* elle sait exprimer sa reconnaissance par rapport à l’action concrète et positive
de Dieu, sachant qu’Il recherche mon bien, comme Paul l’a exprimé dans Ro.8, 28
: "Toutes choses concourent (synergie) au bien de ceux qui aiment (agapao) Dieu
" ;
* elle invente des solutions nouvelles face aux problèmes ;
* elle vise à l’acceptation de soi tout en permettant de combler petit à petit le
décalage entre ce que je suis et ce que je dois devenir transformé par la grâce de Dieu
;
* elle va dans la sens d’une rencontre avec l’autre, de façon directe et
honnête, pratiquant non pas l’exclusion mais le rapprochement, non pas la fusion ou
l’abdication mais la complémentarité dans la différence ;
* elle parvient à l’équilibre entre le rationnel et l’émotif, entre la
réflexion et l’action ;
* elle vise à fournir une réponse adaptée, au bon moment (congruence); dans sa gestion
du temps, elle cherche aussi à se donner les moyens de prendre du recul, de la hauteur,
la distance indispensable à la bonne décision ;
* elle est consciente que certaines choses doivent et peuvent être changées, quand le
moment favorable et mûr est venu (kairos et pléroma) ;
* elle comprend que personne n’est la simple victime de forces déterminantes qui
nous échappent, mais qu’au contraire les êtres responsables que nous sommes doivent
assumer l’exercice de leurs fonctions, de leurs rôles, de leur statut d’acteur
(et pas simple spectateur) ;
* elle permet de faire un travail sur soi-même, dans le sens de l’acquisition
d’une saine estime de soi (qui n’a rien à voir avec l’égoïsme ou
l’orgueil), en connaissant ses limites (à dépasser), ses points forts (à
optimaliser), selon l’ordre de Jésus dans Mt.22, 39 : " Aime ton prochain comme
toi-même ". L’amour de/pour Dieu doit déboucher sur l’amour de soi et du
prochain ;
* elle s’efforce de maintenir une santé physique, mentale et spirituelle solide, en
développant mes capacités et mes activités intellectuelles, spirituelles et créatives,
tout en aimant, nourrissant en appréciant les gens auxquels je tiens (y compris
moi-même), dans la complémentarité entre la dimension horizontale et verticale ;
* elle me permet de m’investir en faveur de causes significatives, qui représentent
un défi dans la lutte contre le mal, me permettant de me transcender, de manière à
faire de ma communauté d’appartenance un lieu de croissance pour chacun ;
* elle cherche à concilier des polarités complémentaires tells la proximité et la
distance, l’intensité du moment et la durée, la ressemblance te la différence, la
parole et le silence, la présence et l’absence, le renouveau et la stabilité…
;
* elle permet un comportement adapté au niveau social et
relationnel : la personne immature dans un groupe, elle, ne participe pas, elle consomme
ou critique les autres, s’accrochant obstinément à son droit de dire ce
qu’elle pense, minimalisant la contribution des autres. Du point de vue de l’affirmation
du moi, elle est passive ou soumise, se révoltant le moment venu, ou bien
agressive, incapable d’utiliser le moi assertif (acceptant
d’être remise en question ou d’affirmer quelque chose). Le moi immature est
aussi l’auto stoppeur ou le mimétique, qui n’a pas d’idée originale,
s’accrochant au dernier wagon. Le plaideur lui est obsédé par des idées fixes et
plaide constamment pour une cause particulière, à moins qu’il ne soit boudeur et ne
peut survivre au rejet de son idée, car se sentant lui rejeté. La personne mûre
propose, innove, fait évoluer la discussion, encourage autrui à participer à son propre
projet, ou à continuer dans le sien. Elle montre un esprit de clarification quand règne
le désordre ou la confusion. Elle aide à gérer les conflits tout en mettant en
évidence les ambiguïtés. * * Elle développe un esprit d’analyse, la capacité de
voir un problème de près tout en gardant une certaine distance pour ne pas s’y
noyer, capable de peser le pour et le contre. Elle favorise aussi l’esprit
d’exploration, ayant une base solide sur laquelle s’appuyer en allant vers de
nouveaux domaines (esprit créatif qui ne se satisfait pas que du traditionnel). Enfin
elle joue un rôle de médiateur, essayant de trouver des solutions acceptables pour tous
les courants qui s’expriment, mettant au point une synthèse qui rassemble les
différents éléments du puzzle et qui mobilise les énergies vers un but commun.
* La foi mûre fait preuve de réalisme, cherchant plus à gérer les
problèmes qu’à les éviter, sachant
qu’ils font partie intégrante de la vie du croyant, surtout depuis l’irruption
du péché (hamartiologie). Chaque enfant de Dieu ayant son désert à franchir, ses
crises à traverser, ce qui du point de vue de la théologie nous renvoie aux trois
baptêmes (eau, esprit, feu), que Jésus lui-même a connus : il fut baptisé d’eau
par Jean-Baptiste, puis d’Esprit sous forme de colombe, et enfin de feu, dans le
désert face à la tentation, avant de connaître d’autres épreuves
(incompréhension, rejet, trahison, crucifixion, mort… ce qu’il évoque dans
Lc.12, 49-50) ;
* La gestion des crises me rappelle le rythme des saisons, avec
les hauts et les bas respectifs. On peut la représenter par une spirale, où la crise
concernée est à considérer dans sa dynamique de phase ascendante et descendante,
impliquant de manière plus générale un équilibre à trouver entre les forces
centripètes et les forces centrifuges.
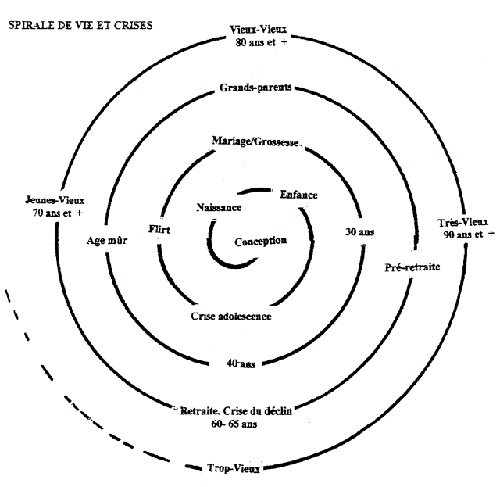
|
Dans la spirale des crises, il y a alternance entre
période ascendante et période descendante de dépression. Le croyant retrouve aussi ce
rythme dans sa vie personnelle et collective ; avec d’un côté l'ombre de la
séparation, du départ, de la mort, de la distance, et de l’autre la lumière des
retrouvailles, du retour, de la résurrection, de la proximité…
La spirale de la vie commence par le temps de la conception, puis celui de la naissance,
synonyme de la première crise d’indépendance au sortir de la vie fusionnelle
intra-utérine. Le mouvement global est celui d’une roue, partant d’un axe
central pour aller vers l’extérieur en s’agrandissant. Le moment de la
conception ne représente pas que le côté physique (rencontre spermatozoïde avec
ovule), mais aussi le désir : désir de l’enfant, désir de continuation, besoin de
se réaliser, incarner un amour dans un être… La vie intra-utérine était bien
protégée, et les trois premiers mois de la grossesse sont une phase délicate à passer,
avec le besoin d’acceptation, la peur de la fausse couche, l’acceptation ou le
rejet toujours possible, la crainte des complications…
Du 3ème au 6ème mois, tout va bien en général, bébé se développe, se fait sentir,
il bouge sans prendre trop de place. Après le 6ème mois, le temps de l’accouchement
se dessine, la récolte succède à la moisson, appréhendé comme un rendez-vous espéré
et redouté, comme un cap à passer, temps fort et en creux, fin d’une première
boucle pour passer à une autre phase. Traumatisme et délivrance de l’accouchement,
puis après la naissance, les douleurs de l’enfantement sont vite oubliées car les
parents sont absorbés par de nouvelles tâches.
Puis commence le cycle de la petite enfance, jusqu’à la période préscolaire, avec
la première crise vers 4-5ans, durant laquelle la toute-puissance parentale est remise en
question, puis vient la période de latence de l’enfance, puis l’adolescence,
etc.… Nous constatons que chaque creux correspond à une crise de la vie : en la
plaçant dans la dynamique circulaire, nous pouvons imaginer la force centrifuge qui
permet un passage et propulse vers de nouvelles hauteurs. Chaque phase de la vie doit
être lue et interprétée dans cette perspective : dans la phase descendante, il ne faut
pas se décourager, et dans la phase ascendante, il faut revenir sur terre et faire
attention à l’atterrissage.
Le processus de développement est lié à ces passages obligatoires que sont les crises.
Elles peuvent être psychosociales, affectives, intellectuelles, existentielles ou
spirituelles. Chacune d’elles est souvent liée à la notion de perte et de deuil à
faire. Deuil à faire de la perte d’un objet (une chose précieuse, un être cher
…), d’une fonction (handicap, chômage après la perte de l’emploi…).
Ces passages obligés éveillent des sentiments négatifs et/ des attitudes
dysfonctionnelles comme la colère, l’hostilité, la jalousie, l’amertume,
l’agressivité, l’insécurité, la déprime, la méfiance envers autrui, le
repli sur soi, la rancœur, la négation de soi et de l’autre, le ressentiment,
l’hostilité plus ou moins ouverte envers les hommes et Dieu, autant
d’éléments qui peuvent être pré sent dans la foi, mais qui n’empêchent pas
d’avancer, d’y substituer des sentiments positifs et des comportements adaptés
comme la confiance, le pardon, la réconciliation, la joie, l’espérance,
l’acceptation, l’instauration du dialogue, de la prière, la persistance de la
capacité à croire quand même, malgré la souffrance, car sachant que toute espérance
est pascale et avec l’hygiène mentale de base : " ne laisse pas le soleil se
coucher sur ta colère " (Ep.4, 26).
2. De la perception du vrai Dieu comme élément vital de
la foi
La Bible présente plusieurs facettes de Dieu, et différentes attitudes à son égard.
Une palette riche et variée pour saisir un peu mieux la grandeur de Dieu, mais ce ne sont
que des moyens imparfaits pour tenter de le rendre un peu plus transparent. Dans Ro.8,
15-16 deux types de relations avec Lui sont esquissés : soit un esprit de servitude, qui
craint Dieu, soit un esprit d’adoption qui nous permet de nous adresser à Lui comme
à un père proche, comme à un papa, car l’Esprit agit sur notre esprit pour
confirmer que nous sommes enfants de Dieu : " Et vous n’avez pas reçu un esprit
de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit
d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ".
La Bible fait apparaître diverses facettes de son être, avec d’un côté le Dieu
Tout-Puissant, le créateur de l’univers, l’inaccessible, l’invisible, le
Dieu-courroucé, vengeur, le grand juge de la fin des temps, le Dieu de justice trois fois
saint ; et de l’autre côté celle d’un Dieu de tendresse et de sollicitude, qui
entretient des relations avec les hommes, qui les aime, les entoure de ses soins, veillant
jalousement sur eux, les recherchant et les protégeant. Dieu qui est le père céleste,
celui qui console comme une mère : " Comme un homme que sa mère console, ainsi je
vous consolerai… " (Es.66, 13).
Dans la Bible est dessinée une palette colorée mettant en œuvre des récits
d’hommes qui, chacun de manière différente, ont rencontré leur créateur. On y
découvre des hommes qui s’abandonnent en toute confiance à ce Dieu paternel qui
aime et qui pourvoit ; d’autres qui souffrent de voir passif ce Dieu qui semble
livrer Son peuple aux armées brutales des nations lointaines, ou qui permet qu’un
Job soit éprouvé au-delà de toute mesure, sans cause apparente. Le psalmiste interpelle
souvent Dieu, lui rappelle Ses promesses, Lui reprochant de ne pas les avoir tenues
toutes, mais qui s’attache cependant de toutes ses forces à son indéfectible
fidélité. Les prières des hommes et des femmes nous révèlent l’univers de leurs
états d’âmes, nous parlant de leurs luttes avec Dieu, qui étaient aussi des luttes
avec eux-mêmes.
Notre perception de Dieu est malheureusement souvent faussée par des traumatismes de la
vie, par une mauvaise éducation, ou par des exemples parentaux pas à la hauteur, car
trop cool ou trop sévères (les extrêmes produisant souvent les mêmes méfaits). Parmi
les images faussées ou dénaturées de Dieu, nous pouvons distinguer celle du
1. Dieu marionnettiste:
l’homme ne serait qu’un pantin désarticulé entre ses mains ;
2. Dieu " donnant-donnant à la Anselme ":
les relations de l’homme et de Dieu seraient régies par la loi de la récompense et
de la punition, du méchant à amadouer par des bonnes actions à accomplir, de la colère
à apaiser, du courroux à satisfaire ;
3. Dieu juge: il tient compte de
toutes nos actions et attend que nous fassions un faux pas pour nous tomber dessous ;
4. Dieu guru: assis sur des nuages de
coton rose, en position de yogi, il se relaxe, attendant, tout au long du jour, nos
sacrifices et nos hommages ;
5. Dieu inspecteur: tel Sherlock
Holmes, il porte une gabardine de détective et des lunettes noires. Il nous suit à peu
de distance, prêt à bondir sur nous dès qu’il nous prend en faute, ou dès
qu’il a une preuve à charge contre nous ;
6. Dieu philosophe à la Aristote:
créateur immuable de l’univers, renfermé, froid et distant, il est trop occupé à
diriger le mouvement des planètes pour s’intéresser à nos problèmes insignifiants
;
7. Dieu pharaon: directeur de travaux
insatiable, il ne cesse d’alourdir ses exigences à l’image du pharaon qui
opprimait les Hébreux.
8. Dieu contrôleur: qui sait tout,
voit tout, passant son temps à m’espionner, à m’épier et à
m’empoisonner la vie, m’interdisant de " perdre mon temps " dans des
choses inutiles ou futiles comme lire un livre, écouter un disque… ;
9. Dieu contrôleur: qui sait tout,
voit tout, passant son temps à m’espionner, à m’épier et à
m’empoisonner la vie, m’interdisant de " perdre mon temps " dans des
choses inutiles ou futiles comme lire un livre, écouter un disque… ;
Jésus a dit à Philippe : " Qui m’a vu a vu le Père " (Jn.14, 9), et il
faut vérifier le regard que nous jetons sur lui. L’image du père qui apparaît en
Jésus ne doit pas être une représentation incomplète ou une image déformée ; car
nous avons tendance à enfermer les gens que nous aimons dans l’esquisse que nous
nous faisons d’eux. Au lieu de corriger notre esquisse, au lieu de rectifier notre
représentation, nous avons tendance à corriger les gens pour les faire entrer dans notre
moule. Nous ne devons pas adapter Dieu à nos représentations irréalistes et à nos
figures lacunaires, en taillant une image de Dieu à notre convenance. Dans les
conceptions erronées présentées, Dieu n’est pas digne d’amour, car il
n’est plus digne de confiance. Notre colère est plutôt dirigée contre le
pseudo-Dieu de nos fausses représentations.
La psychologie nous aide à prendre conscience que certaines de nos convictions intimes
sont erronées, que certains de nos faux schémas mentaux sont faux (et à changer),
qu’ils engendrent des troubles psychiques (à surmonter), des sentiments négatifs
(à modifier) et des dysfonctionnements dans le comportement (à rectifier). Leurs racines
sont souvent profondes et lointaines, demandant un travail sur notre " logique
interne ".
Tel enfant a assisté à la maladie douloureuse d’une maman qu’il aimait
beaucoup et qui décède. Son image de Dieu risque d’en être tordue et faussée :
Dieu est injuste, sans compassion, ingrat. Pour une autre personne qui a connu les camps
de concentration, Dieu est brutal, tyrannique, sans cœur… Beaucoup de nos images
de Dieu sont contaminées par la peur :
* peur d’être ridiculisé (manque de confiance en soi),
* peur d'être déçu,
* peur d'être puni (sentiment de culpabilité),
* peur de ne pas être à la hauteur (sentiment de honte),
* peur d'être rejeté, non accepté...
Cette peur est souvent conditionnée par la crainte de perdre notre valeur aux yeux
d’autrui et du même coup elle induit une perturbation relationnelle. Jésus nous
invite à prendre le risque de la confiance, d’accorder notre confiance à Dieu, pour
avancer sur le chemin de l’aventure de la vie, en élargissant le champ des
expériences et en affinant les contours du visage de Dieu. Du même coup nous pouvons
alimenter une foi plus mûre et sereine, moins contaminée par ces éléments nocifs que
nous risquons fort de cumuler, à savoir,
* une image de Dieu éclatée et morcelée,
* une certaine méfiance envers Dieu,
* la crainte d’être condamné, voué à la damnation ou à la condamnation,
* un manque de confiance en soi et le dénigrement de sa propre valeur,
le besoin d’accomplir de bonnes œuvres et de prouver la qualité de la piété
personnelle,
* une certaine tendance à fuir les responsabilités par le refus de s’engager, pour
jouer un rôle de spectateur, pas d’acteur,
* la peur, voire l’angoisse de ne pas être à la hauteur des attentes de Dieu,
d’autrui,
* le sentiment d’être incapable d’affronter les exigences de la vie,
* la rupture des liens relationnels personnels et interpersonnels.
* le ressentiment qui dure, qui fait irruption au moment où nous nous y attendons le
moins, qui provoque le chagrin et la douleur, empêchant la vraie guérison qui elle ne
supprime pas le souvenir, mais la souffrance qui s’y rattachait et qui tourmentait la
vie.
l'incapacité de se donner à Dieu, l’incapacité de Lui faire confiance,
l’idée qu’il est un père qui donne une pierre alors qu’on lui demande du
pain, autant d’éléments qui proviennent souvent du fait que nous identifions Dieu
à des personnages déloyaux, imprévisibles, capricieux, versatiles, et dont nous nous
méfions (parents indignes, pas à la hauteur, personnes ayant joué un rôle important
mais ayant provoqué une blessure affective ou le ressentiment suite à l’injustice
dont elles se sont rendues coupables…).
Floyd McCLUNG, Dieu, un cœur de père, Editions Jeunesse en Mission, Burtigny,
Suisse, 1995, développe l’image du cœur de notre père divin.
p.42 : Os.11,4 : " Je les tirerai avec des liens d’humanité, avec des cordages
d’amour… ". Par l’amour de Dieu, nous nous savons bien entourés,
libérés de la crainte des autres, du désir de rechercher leur approbation, mais sommes
remplis de la crainte de Dieu, crainte qui présente différents aspects :
* c’est la haine du péché ; " la crainte de l’Eternel,
c’est la haine du mal " (Pr.8,13),
* elle va de pair avec l’amitié et l’intimité avec Dieu : " Vous qui
aimez l’Eternel, haïssez le mal ! " (Ps.97,10). " L’amitié de
l’Eternel est pour ceux qui le craignent " (Ps.25,14),
* C’est une crainte respectueuse, qui s’étend à toute la création : "
Que toute la terre craigne l’Eternel ! " (Ps.33,8).
* " La crainte de l’Eternel est le commencement de la science, de la sagesse
" (Pr.1,7).
p.48-66 : Nous sommes guéris par l’amour de Dieu :
1ère étape : reconnaître qu’on a besoin de
guérison. Il faut confesser le péché sur le plan où il a été commis :
le péché secret (en pensée, dans le cœur), doit être confessé dans le secret de
ma rencontre avec Dieu,
le péché privé (en acte, mais pas en public, ce n’est pas connu), exige de
demander pardon à celui a qui on a fait le mal, envers qui on a commis le tort,
le péché public : au groupe, à la communauté. En tout cas, il faut le pardon (accordé
et reçu).
Pour le péché, il faut le pardon, l’effacement de la faute, pour la blessure, il
faut la guérison, restaurer le lien rompu, ou délivrer de celui qui est nuisible.
2ème étape : confesser les émotions négatives
telles que la méfiance, la colère, la rancœur, le ressentiment…
3ème étape : pardonner à ceux qui nous ont
offensé, blessé…
4ème étape : recevoir le pardon,
5ème étape : recevoir l’amour de Dieu, passer
du temps avec lui, le fréquenter intimement, l’adorer, le prier,
6ème étape : avoir les pensées de Dieu : " Tu
aimeras ton prochain comme toi-même " (Lé.19,18 et Mt.22,34-40).
7ème étape : être persévérant. " Si nous
persévérons, nous régnerons avec lui " (2Ti.2,12). Eviter de baisser les bras, de
se résigner.
La maturation émotionnelle et spirituelle est progressive, s’inscrit dans le
processus de maturation de la famille de Dieu.
p.70-72: Il faut vaincre l’orgueil et ses différentes manifestations,
* l’orgueil voit les torts des autres, mais n’admet pas leurs
faiblesses,
* il n’admet ni son erreur ni sa propre responsabilité. S’il les admet,
s’en tire avec des excuses et des explications qui excluent tout regret de la faute
commise,
* il blâme les autres, les juge, et démontre pourquoi ils ont tort,
* il engendre la dureté, l’arrogance, la suffisance,
* il cherche à être bien vu des homes, plutôt que de plaire à Dieu,
* il cherche à avoir le dernier mot,
* il ne dit jamais : " J’ai tort, pardonnez-moi ",
* il engendre l’intransigeance, il porte plus son attention sur la passé et le futur
que sur le présent,
* il est diviseur, sectaire,
* il déchire, détruit, cancane, détruit les réputations,
* il tient les autres ou Dieu pour responsables de ce qui ne va pas,
* il excuse l’amertume et le ressentiment,
* il se plaint toujours,
* il se fonde sur une conception erronée de la propre justice et non sur la croix de
Jésus.
C’est au travers d’expériences douloureuses qu’on apprend ce qu’il
est.
p.78 : le cœur brisé de Dieu.
p.83 : il y a une tristesse selon Dieu : 2 Co.7,9-10 : " je me réjouis à cette
heure, non pas de ce que vous ayez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a
porté à la repentance ; car vous avez été attristés selon Dieu afin de ne recevoir de
notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à
salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort
".
p.85 : souvent on rejette non pas Dieu, mais les fausses images de lui. Il y a trois
fausses images de Dieu dominantes :
* celle du Dieu arbitraire,
* celle du Dieu de l’indifférence,
* celle du Dieu du privilège et de la prospérité.
Dieu est plutôt un père qui nous attend, comme le dit la parabole de Luc 15 : il nous
laisse la liberté de décider, il nous attend patiemment, il nous accepte de manière
inconditionnelle.
p.96-98 : caractères de Dieu :
- créateur (Act.17,58),
- généreux (Mt.7,11),
- ami et conseiller (Jé.3,4 ; Es.9,5),
- éducateur (Hé.12,5),
- rédempteur compatissant (Ps.103, 8-12),
- consolateur (2Co.1,3-4),
- défenseur et libérateur (Ps.91,1-3),
- père (2Co.6,18),
- père des orphelins, prend soin (Ps.68,6-7),
- père d’amour (Jn.16,27).
Nous pouvons cultiver l’intimité avec lui et la reconnaissance à son égard.
p.100ss : des Pères dans le Seigneur.
Nous devons paître le troupeau, 1Pi.5,2 (p o i m a n a t e ) ; être des
pères (1Th.2,7,11,12)
|